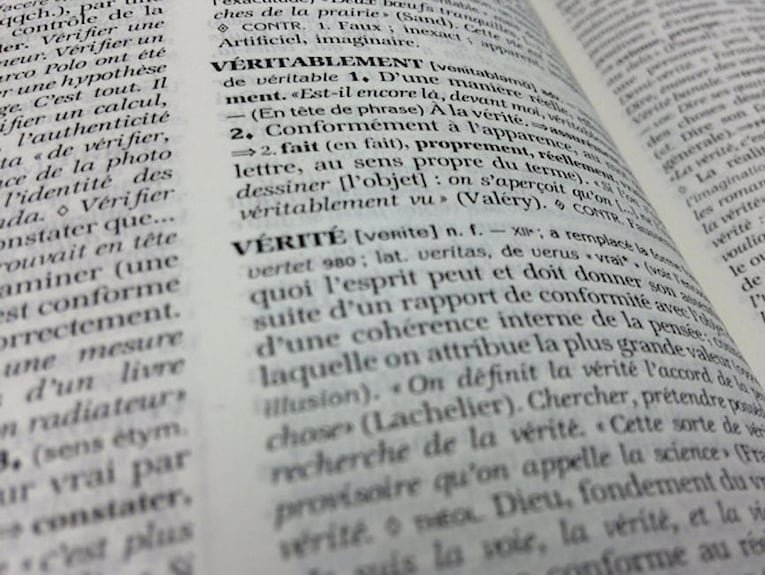Le fait en politique : une approche anthropologique du discours public
Quand, en conseil municipal, un adjoint annonce que « la commune a perdu 15 habitants cette année », énonce-t-il un fait ou engage-t-il déjà une lecture politique de la démographie locale ? Cette question, apparemment anodine, m’accompagne depuis des années dans ma pratique de maire d’une commune rurale. Elle structure également mon travail d’anthropologue des institutions et du travail local.
La nature du fait en politique n’est pas seulement une interrogation philosophique abstraite. Elle conditionne notre capacité collective à délibérer. Elle traverse les assemblées municipales comme les hémicycles parlementaires. Elle structure les débats budgétaires comme les controverses sur les services publics. Dans nos démocraties contemporaines, la question « qu’est-ce qu’un fait ? » détermine la qualité même de notre vie démocratique.
Cet article propose une réflexion anthropologique sur la manière dont les faits sont produits, mobilisés et mis en récit dans l’espace politique français contemporain. Il ne s’agit pas de trancher définitivement une question ontologique, mais d’offrir des outils analytiques issus de l’ethnographie du discours politique pour comprendre comment s’opère, dans nos institutions, le passage de la donnée brute à l’argument partisan.
L’objectivité factuelle à l’épreuve de l’anthropologie
L’anthropologie entretient depuis ses origines une relation complexe à la notion de fait. Si Malinowski enjoignait l’ethnographe à distinguer rigoureusement les « faits observables » de leur interprétation culturelle, la discipline a progressivement intégré que l’observation elle-même est toujours située, que le regard de l’anthropologue n’est jamais neutre. Comme l’écrivait Terray, tout fait social est « doublement déterminé » : par les structures objectives qui le produisent et par les catégories subjectives qui le rendent intelligible.
En politique, cette tension entre objectivité et construction sociale prend une acuité particulière. Un fait politique ( comme le taux de chômage calculé par l’INSEE selon la définition du BIT) est à la fois parfaitement objectivable (protocole de mesure standardisé, vérifiable, reproductible) et profondément construit (choix méthodologiques, conventions statistiques, décisions sur ce que l’on entend exactement par « chercher un emploi »). Cette dualité n’invalide pas la notion de fait. Elle oblige simplement à penser sa production sociale.
Prenons l’exemple des débats budgétaires de l’automne 2024. Lorsque le gouvernement Barnier a présenté un projet de loi de finances affichant un déficit public de 5% du PIB pour 2025, ce chiffre constituait-il un fait brut ? Oui, au sens où il résultait d’une comptabilité publique normée (le Système Européen des Comptes 2010) et pouvait être vérifié par des organismes indépendants. Non, au sens où sa production supposait des choix techniques complexes : quelle part des dépenses de l’État attribuer à telle ou telle année ? Comment comptabiliser les engagements hors bilan ? Comment anticiper les recettes fiscales ?
Cette dimension construite n’autorise pas pour autant le relativisme. Entre le positivisme naïf qui croirait aux faits « purs » et le constructivisme radical qui dissoudrait toute objectivité, l’anthropologie politique propose une voie médiane : reconnaître la construction sociale des faits sans renoncer à leur fonction régulatrice dans le débat démocratique.
La mise en récit : du chiffre à l’argument
Ce qui distingue le discours politique du constat statistique, c’est précisément l’opération de mise en récit. Le fait sert de matière première à des constructions narratives concurrentes. Cette transformation s’opère par trois mécanismes que l’ethnographie du discours permet d’identifier :
- La sélection stratégique d’abord. Dans le foisonnement des données disponibles, les acteurs politiques ne retiennent que celles qui servent leur démonstration. Lors du débat sur la réforme des retraites au printemps 2023, le gouvernement mettait en avant les projections démographiques du Conseil d’orientation des retraites (COR) montrant un déséquilibre financier à moyen terme, tandis que l’opposition privilégiait d’autres données du même COR indiquant la soutenabilité du système sous certains scénarios macroéconomiques. Les deux camps s’appuyaient sur des faits vérifiables, issus du même organisme public. La sélection opérée orientait déjà le récit.
- Le cadrage interprétatif ensuite. Goffman, dont les travaux ont profondément influencé l’anthropologie cognitive, a montré que nous appréhendons toujours la réalité à travers des « cadres » qui organisent notre expérience. En politique, un même fait peut être inscrit dans des cadrages radicalement différents. Le déficit public de 5% devient, selon les locuteurs, « une performance remarquable compte tenu du contexte de guerre en Ukraine » ou « un échec inacceptable de la gestion macroniste ». Le chiffre reste identique. Sa signification ne l’est clairement pas.
- La rhétorique qualificative enfin. L’analyse du discours politique révèle que le passage du fait à l’argument s’opère par l’adjonction de marqueurs rhétoriques : adjectifs qualificatifs (« massif », « inacceptable », « maîtrisé »), métaphores (l’« hémorragie » budgétaire, le « mur » de la dette), modalisateurs (« évidemment », « malheureusement »). Ces éléments linguistiques signalent l’irruption du jugement de valeur dans l’énoncé factuel
Observons un autre cas concret. En octobre 2024, lors des débats sur le budget de la Sécurité sociale, Bruno Le Maire déclarait : « Nous avons réussi à maintenir le déficit à un niveau soutenable malgré les crises successives ». Quelques jours plus tard, Marine Le Pen affirmait : « Le gouvernement laisse filer dangereusement les comptes publics vers l’abîme ». Les deux s’appuyaient sur les mêmes données de l’Insee et de la Cour des comptes. Mais là où l’un voyait « maintien » et « soutenabilité », l’autre dénonçait un « laisser-filer dangereux » vers l’« abîme ». L’adjectif « soutenable » contre la métaphore de l’« abîme » : toute la distance entre le fait et sa mobilisation politique.
L’ère de la post-vérité : fragmentation des régimes de validation
Le concept de post-vérité, élu mot de l’année 2016 par l’Oxford Dictionary, désigne un régime de communication où « les faits objectifs ont moins d’influence pour modeler l’opinion publique que les appels à l’émotion et aux croyances personnelles ». Cette notion a rapidement gagné l’espace politique français.
La post-vérité ne signifie pas, me semble t’il, la disparition du fait mais une transformation des modalités de sa validation sociale. Nous assistons à une fragmentation des régimes de vérité : chaque communauté politique développe ses propres instances de certification du vrai. Les fact-checkeurs du Monde et de Libération font autorité pour certains publics. Pour d’autres, ce sont les « réinformateurs » de CNews ou les influenceurs de réseaux sociaux. Cette pluralisation des autorités épistémiques fragilise l’existence d’un socle factuel partagé.
J’en observe les effets concrets dans ma pratique municipale. Lors d’une récente réunion publique sur un projet d’aménagement, un habitant contesta les chiffres de population que je présentais, issus du recensement INSEE, en m’opposant des « données alternatives » trouvées sur Facebook. La confiance dans l’institut statistique public, qui fondait traditionnellement un accord minimal sur les données démographiques, se trouve érodée au profit de sources dont la légitimité repose davantage sur la proximité idéologique que sur la rigueur méthodologique.
Cette émotionnalisation du rapport aux faits constitue une mutation anthropologique profonde. Bourdieu avait montré que le champ politique obéit à une logique propre, irréductible à la rationalité scientifique. Mais il existait encore, dans les années 1980-1990, une relative déférence envers l’expertise technique. Aujourd’hui, la « vérité du cœur » (ce que les Américains nomment truthiness) concurrence frontalement la vérité démonstrative. Un énoncé sera tenu pour vrai non parce qu’il peut être vérifié, mais parce qu’il « résonne » avec les convictions préexistantes de son public.
Distinguer le fait de son interprétation : outils d’analyse du discours
Face à cette confusion entretenue entre donnée et opinion, l’analyse anthropologique du discours offre des outils de démêlage. Il s’agit moins de prétendre à une impossible neutralité que de rendre visibles les opérations rhétoriques par lesquelles s’élabore la parole politique.
On peut identifier plusieurs marqueurs linguistiques qui signalent le passage du constat à l’interprétation. Les adjectifs qualificatifs d’abord : comparer « le déficit atteint 5% » (énoncé vérifiable) et « le déficit atteint un niveau catastrophique de 5% » (fait + qualification axiologique). L’adjectif « catastrophique » introduit un jugement qui n’appartient pas au chiffre lui-même. De même, qualifier de « massif » un taux d’immigration ou d’« insupportable » une pression fiscale, c’est déjà interpréter les données dans un cadre émotionnel et normatif.
Les métaphores ensuite, qui ne se contentent pas de décrire mais imposent un schéma explicatif. Parler d’« hémorragie » budgétaire n’est pas neutre : la métaphore médicale pathologise la situation, suggère l’urgence vitale, appelle des remèdes drastiques. De même, les images du « tsunami » migratoire, de l’« asphyxie » fiscale ou du « matraquage » réglementaire ne décrivent pas des faits mais les inscrivent dans des récits catastrophistes qui orientent l’action publique.
Les modalisateurs également : les adverbes comme « évidemment », « naturellement », « malheureusement » révèlent le point de vue de l’énonciateur. Dire « le déficit atteint malheureusement 5% » n’est plus décrire un état budgétaire mais exprimer un regret, donc un jugement normatif sur ce que devrait être le bon niveau de déficit.
Enfin, la temporalité narrative elle-même constitue un outil rhétorique. Présenter un chiffre isolé ou l’inscrire dans une série historique ne produit pas le même effet de sens. Annoncer « 5% de déficit » sans autre précision laisse l’auditeur démuni. Dire « 5%, soit le même niveau qu’en 2023 » suggère la stabilité. Affirmer « 5%, en hausse continue depuis trois ans » installe un récit de dégradation. Le fait reste identique ; sa mise en intrigue diverge.
La performativité du discours politique : quand dire, c’est faire
L’anthropologie du langage, héritière d’Austin et de sa théorie des actes de langage, nous rappelle que certains énoncés ne décrivent pas le monde mais le transforment. Lorsqu’un maire proclame l’ouverture d’une séance de conseil municipal, il ne constate pas un fait. Il le crée performativement. De même, lorsqu’un Président décrète l’état d’urgence, il ne décrit pas une situation préexistante mais institue un nouveau cadre juridique.
Cette performativité concerne aussi les faits : leur publicisation, leur mise en scène médiatique, leur inscription dans une narration politique modifient leur statut social. Un taux de chômage reste un chiffre technique tant qu’il demeure dans les fichiers de Pôle Emploi. Il devient un enjeu politique par l’acte même de son énonciation publique. La sociologue Foucault l’avait magistralement montré : le discours sur les populations ne se contente pas de les décrire, il participe à leur constitution comme objets de gouvernement.
J’en fais l’expérience dans ma pratique municipale. Lorsque, en conseil, j’annonce que « la commune compte désormais 438 habitants contre 420 il y a cinq ans », je ne formule pas un simple constat démographique. Je produis un fait politique qui va structurer les délibérations, justifier ou non des investissements, orienter des choix d’aménagement. Le chiffre INSEE existait avant mon énonciation. Sa transformation en argument d’action publique résulte de sa mise en discours.
Cette dimension performative explique pourquoi les acteurs politiques se battent avec tant d’acharnement sur les qualifications. Dire « crise » ou « difficulté conjoncturelle », « réforme » ou « casse sociale », « relance » ou « démagogie budgétaire », ce n’est pas seulement décrire différemment une même réalité, c’est construire des réalités politiques divergentes qui appellent des réponses radicalement différentes.
L’exemple du budget 2025 : anatomie d’une controverse factuelle
Reprenons méthodiquement le cas du projet de loi de finances pour 2025, présenté à l’automne 2024 par le gouvernement Barnier. Ce cas d’école illustre parfaitement les mécanismes analysés.
- Le socle factuel minimal : selon les comptes publics établis par Bercy et validés par la Cour des comptes, le déficit public prévu pour 2025 s’établit à 5,0% du PIB, contre 4,4% en 2024 (prévision révisée) et 4,9% en 2023. Ces chiffres, produits selon la méthodologie du Système Européen des Comptes (SEC 2010), sont vérifiables et font l’objet d’un consensus technique entre les différentes institutions de contrôle.
- La mise en série divergente : le gouvernement inscrit ce 5% dans une trajectoire de redressement progressif après les « années Covid » (déficit de 9,2% en 2020, 6,6% en 2021), soulignant que « malgré les crises successives, nous revenons vers la normale ». L’opposition de gauche, elle, compare aux années 2017-2019 (déficit moyen de 2,4%) et dénonce une « dérive inédite ». L’opposition de droite compare aux années Fillon (1,5% en moyenne) et parle de « laxisme budgétaire ». Le fait (5%) reste stable ; les séries temporelles mobilisées construisent des récits opposés
- Les qualifications partisanes :
Le Premier ministre Michel Barnier, dans son discours de politique générale d’octobre 2024, déclarait : « Nous héritons d’une situation budgétaire dégradée mais gérable, qui nécessite des efforts partagés mais raisonnables pour revenir vers l’équilibre ». Chaque terme compte : « dégradée » reconnaît la difficulté tout en la relativisant par « gérable » ; « efforts » euphémise les restrictions budgétaires ; « partagés » active le registre de la justice ; « raisonnables » rassure ; « revenir vers l’équilibre » inscrit dans une temporalité optimiste.
Marine Le Pen, quelques jours plus tard : « Ce gouvernement laisse les comptes publics partir à la dérive de manière irresponsable, hypothéquant l’avenir de nos enfants ». Le vocabulaire diffère radicalement : « dérive » (perte de contrôle), « irresponsable » (faute morale), « hypothéquer l’avenir » (mise en péril existentielle), « nos enfants » (appel émotionnel). Même chiffre de départ (5%), récits antagoniques.
Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l’Assemblée : « Ces chiffres catastrophiques sont le résultat direct de l’obstination néolibérale à refuser la justice fiscale ». Ici, l’adjectif « catastrophiques », l’attribution causale (« résultat direct »), la qualification idéologique (« obstination néolibérale ») et le cadrage normatif (« justice fiscale ») transforment intégralement la donnée budgétaire. - Les silences stratégiques : l’analyse anthropologique doit aussi s’intéresser à ce qui n’est pas dit. Le gouvernement mentionne peu la comparaison avec l’Allemagne (déficit estimé à 2,1% en 2025), l’opposition de gauche passe sous silence les pays méditerranéens aux déficits plus élevés (Italie, Grèce), l’opposition de droite évoque rarement que les années Fillon s’inscrivaient dans un contexte économique différent. Chaque camp sélectionne les faits qui servent sa démonstration, occulte ceux qui la fragilisent.
Enjeux démocratiques : former l’esprit critique citoyen
Cette capacité à distinguer les faits de leur mise en récit n’est pas une compétence technique réservée aux chercheurs en sciences sociales. C’est une compétence citoyenne fondamentale dans une démocratie délibérative. Trois enjeux majeurs s’en dégagent.
- La qualité du débat public d’abord. Un débat démocratique fécond suppose l’existence d’un socle minimal de faits partagés. Quand tout devient opinion, quand les données les plus robustes sont systématiquement contestées au nom d’« interprétations alternatives », la délibération devient impossible. Nous ne débattons plus de ce qu’il convient de faire face à une situation commune mais de la réalité même de cette situation. Cette impossibilité de s’accorder sur les faits menace directement la démocratie représentative.
- La responsabilité des acteurs politiques ensuite. Distinguer fait et rhétorique permet d’exiger des responsables qu’ils justifient leurs interprétations tout en respectant l’intégrité factuelle. Un élu qui affirme « le chômage explose dans notre région » alors que les données de Pôle Emploi montrent une stabilité doit pouvoir être contredit factuellement. De même, un gouvernement qui proclame « une baisse historique de la délinquance » en sélectionnant uniquement les indicateurs favorables peut être confronté à l’ensemble des statistiques du ministère de l’Intérieur.
- L’éducation à l’esprit critique enfin. Former les citoyens à l’analyse du discours politique, leur donner les outils pour repérer les marqueurs rhétoriques, les sensibiliser aux mécanismes de cadrage et de sélection, c’est leur permettre de résister aux manipulations et de participer activement à la vie démocratique. Cette éducation devrait constituer un axe central de la formation civique, de l’école à l’université.
De mon point de vue de praticien-chercheur, cette formation prend un sens particulier. Dans les communes rurales comme celle que j’administre, l’écart se creuse entre les citoyens qui maîtrisent ces codes analytiques et ceux qui, faute d’outils critiques, adhèrent aux récits les plus émotionnellement puissants sans pouvoir en évaluer la solidité factuelle. Cette fracture épistémologique recoupe largement les fractures sociales et territoriales qui traversent notre pays.
Conclusion : pour une vigilance épistémologique
Le fait en politique n’est jamais « pur ». Il est toujours situé, sélectionné, mis en forme par des acteurs qui poursuivent des objectifs stratégiques. Mais cette inévitable médiation ne nous condamne pas au relativisme postmoderne. Entre le positivisme naïf qui croit aux faits bruts et le nihilisme qui nie toute objectivité, il existe un espace pour ce qu’on pourrait nommer une vigilance épistémologique : reconnaître la construction sociale des faits sans renoncer à leur fonction régulatrice dans le débat démocratique.
C’est précisément cette vigilance que doit cultiver l’anthropologie politique. Non pour prétendre à une neutralité impossible – mon engagement municipal me rappelle quotidiennement que le chercheur est aussi un acteur social situé – mais pour dévoiler les mécanismes par lesquels s’élaborent les vérités politiques. Notre rôle n’est pas de dire la vérité ultime, mais de rendre visibles les opérations rhétoriques et cognitives par lesquelles les faits sont produits, certifiés et mobilisés dans l’espace public.
Cette posture, Emmanuel Terray la résumait par une formule qui guide encore mon travail : « L’anthropologie ne dit pas ce qu’il faut penser, elle montre comment nous pensons ». Appliquée au discours politique, cette maxime nous invite à décrypter les mécanismes de production du sens sans nous ériger en arbitres du vrai et du faux, mais sans renoncer non plus à la distinction entre énoncés vérifiables et constructions rhétoriques.
Dans nos démocraties fragilisées par la défiance envers les institutions, par la fragmentation de l’espace public, par la prolifération des fausses informations, cette vigilance épistémologique devient un enjeu civique de premier ordre. Elle seule peut nous permettre de maintenir l’exigence d’un débat démocratique fondé sur des faits partagés, tout en acceptant la pluralité légitime des interprétations politiques.
Pour aller plus loin :