Le travail moderne et ses paradoxes
Entre rituels vidés de sens et quête de reconnaissance
Le monde du travail contemporain semble traversé par une étrange contradiction. D’un côté, jamais les organisations n’ont autant multiplié les dispositifs de communication, de participation et de valorisation. De l’autre, l’insatisfaction au travail n’a jamais été aussi prégnante. Pour comprendre ce paradoxe, il faut s’intéresser à la manière dont le pouvoir, les rituels organisationnels et la bureaucratie façonnent notre expérience quotidienne du travail.
Les rituels d’entreprise constituent une première clé d’analyse. Comme l’a montré Erving Goffman dans ses travaux sur les interactions sociales, toute organisation produit des rituels qui permettent de maintenir l’ordre symbolique et de réaffirmer les positions de chacun. La réunion du lundi matin, le pot de départ, l’entretien annuel d’évaluation… ne sont pas de simples moments fonctionnels : ce sont des cérémonies qui nous disent qui nous sommes dans l’organisation. Randall Collins a prolongé cette analyse en montrant que ces rituels d’interaction produisent de « l’énergie émotionnelle » qui soude le groupe… ou au contraire le fragmente quand ils sont vécus comme factices ou contraints.
C’est précisément là que le bât blesse. Beaucoup de ces rituels contemporains sont perçus comme « creux », comme des performances obligées qui ne produisent plus de sens collectif. Le fameux « team building » du vendredi après-midi, la réunion où l’on répète ce que tout le monde sait déjà, ces moments où l’on doit jouer l’enthousiasme alors même que les décisions importantes sont prises ailleurs. David Graeber, dans sa théorie des « bullshit jobs », a identifié ces emplois dont même ceux qui les occupent peinent à percevoir l’utilité sociale. Il distingue notamment les « cocheurs de cases » (box tickers) obsédés par les indicateurs de performance, ou les « rafistoleurs » (duct tapers) dont le travail consiste à réparer en permanence des problèmes organisationnels qui ne devraient pas exister. Mais au-delà des métiers entièrement inutiles (ou supposés tels), c’est une partie croissante de nos activités professionnelles qui semble bel et bien relever de cette catégorie : remplir des tableaux de bord que personne ne lira, participer à des réunions de coordination qui n’aboutissent à rien, produire des rapports pour justifier l’existence d’un service… Les exemples sont nombreux.
Cette bureaucratisation du travail n’est pas nouvelle. Michel Crozier, dans « Le phénomène bureaucratique » publié en 1963, avait déjà analysé comment les règles censées rationaliser l’organisation produisent paradoxalement des dysfonctionnements. La multiplication des procédures crée des zones d’incertitude que certains acteurs apprennent à maîtriser pour accroître leur pouvoir. Le règlement devient alors à la fois un carcan et une ressource dans les jeux stratégiques internes.
Mais la bureaucratie contemporaine a pris un tour nouveau. Vincent de Gaulejac, dans ses travaux sur « la société malade de la gestion », montre comment la logique gestionnaire a colonisé tous les espaces du travail, multipliant les dispositifs d’évaluation et de contrôle au nom de la performance. Cette « quantophrénie », cette obsession de tout mesurer et quantifier, produit un sentiment d’absurde d’un ordre nouveau : celui d’être sans cesse évalué sur des critères dont on ne maîtrise pas la pertinence, contraint de justifier en permanence son activité par des indicateurs qui passent à côté de l’essentiel du travail réel.
Cette situation éclaire d’un jour particulier la question de la relation au chef. Pourquoi n’aime-t-on généralement pas son supérieur hiérarchique ? La sociologie des organisations nous donne plusieurs pistes. D’abord, le chef incarne la contrainte organisationnelle : il est celui par qui arrive la charge de travail supplémentaire, la nouvelle procédure inutile, la décision incompréhensible venue d’en haut. Mais plus profondément, c’est la question de la légitimité qui se pose. Dans un monde où les rituels sont vidés de sens, où une partie significative du travail relève du « bullshit », sur quoi peut se fonder l’autorité ? La compétence technique ? Elle est souvent déconnectée du rôle d’encadrement. Le charisme ? Difficile quand on vous demande de relayer des décisions auxquelles vous ne croyez pas vous-même.
C’est ici que s’exprime un effet paradoxal du pouvoir, un pouvoir qui isole celui qui l’exerce. Norbert Elias, dans « La société de cour », a montré comment le pouvoir, loin d’être seulement une ressource, impose aussi des contraintes à celui qui l’exerce. Le chef se retrouve dans une position paradoxale : formellement responsable, mais réellement contraint par les injonctions contradictoires qui lui viennent d’en haut, sommé de motiver des équipes avec des moyens limités, obligé de faire appliquer des règles qu’il sait absurdes. Cette solitude structurelle du chef n’excuse pas les abus de pouvoir ou l’incompétence managériale, mais elle explique en partie pourquoi la relation hiérarchique est si souvent source de tension.
Le cadre intermédiaire, en particulier, incarne cette contradiction. Il doit traduire les objectifs stratégiques en actions concrètes, faire le lien entre les exigences de rentabilité et les réalités du terrain, arbitrer entre des logiques souvent incompatibles. Luc Boltanski et Laurent Thévenot, dans leur théorie des « économies de la grandeur », ont montré que les acteurs au travail jonglent constamment entre différents principes de justification : l’efficacité marchande, l’équité civique, la reconnaissance domestique. Le chef est celui qui doit opérer cette traduction entre des « mondes » qui ne parlent pas le même langage, et il est souvent le premier à en payer le prix psychologique.
Christophe Dejours, dans ses travaux sur la psychodynamique du travail, a documenté les conséquences de ces contradictions : la souffrance éthique de devoir appliquer des directives que l’on juge injustes, les stratégies défensives pour tenir psychiquement, l’usure des managers pris entre leur loyauté envers l’organisation et leur responsabilité envers leurs équipes.
Que faire de ce constat ? Faut-il en conclure que toute organisation est vouée à produire de l’insatisfaction et de l’absurde ? Pas nécessairement. Mais il s’agit de reconnaître que la multiplication des dispositifs de communication et de participation ne résout rien si elle n’est qu’une couche supplémentaire de rituels formels. La vraie question est celle des espaces de délibération réelle, où les acteurs peuvent collectivement interroger le sens de ce qu’ils font. Certaines expériences d’organisation du travail, inspirées notamment des travaux d’Yves Clot sur la « clinique de l’activité », montrent qu’il est possible de recréer des espaces où le travail peut être discuté, où les contradictions peuvent être nommées, où les rituels peuvent retrouver une densité symbolique.
Le diagnostic sociologique n’est pas une fin en soi, mais un point de départ pour penser autrement. Comprendre les mécanismes qui produisent l’isolement lié au pouvoir, la vacuité des rituels et la prolifération des « bullshit jobs » est une première étape pour imaginer des formes d’organisation plus supportables, voire plus émancipatrices. Car derrière la question du travail, c’est bien celle de la vie bonne qui se pose : comment passer une part significative de notre existence dans des activités qui ne nous aliènent pas mais nous permettent de nous réaliser ?


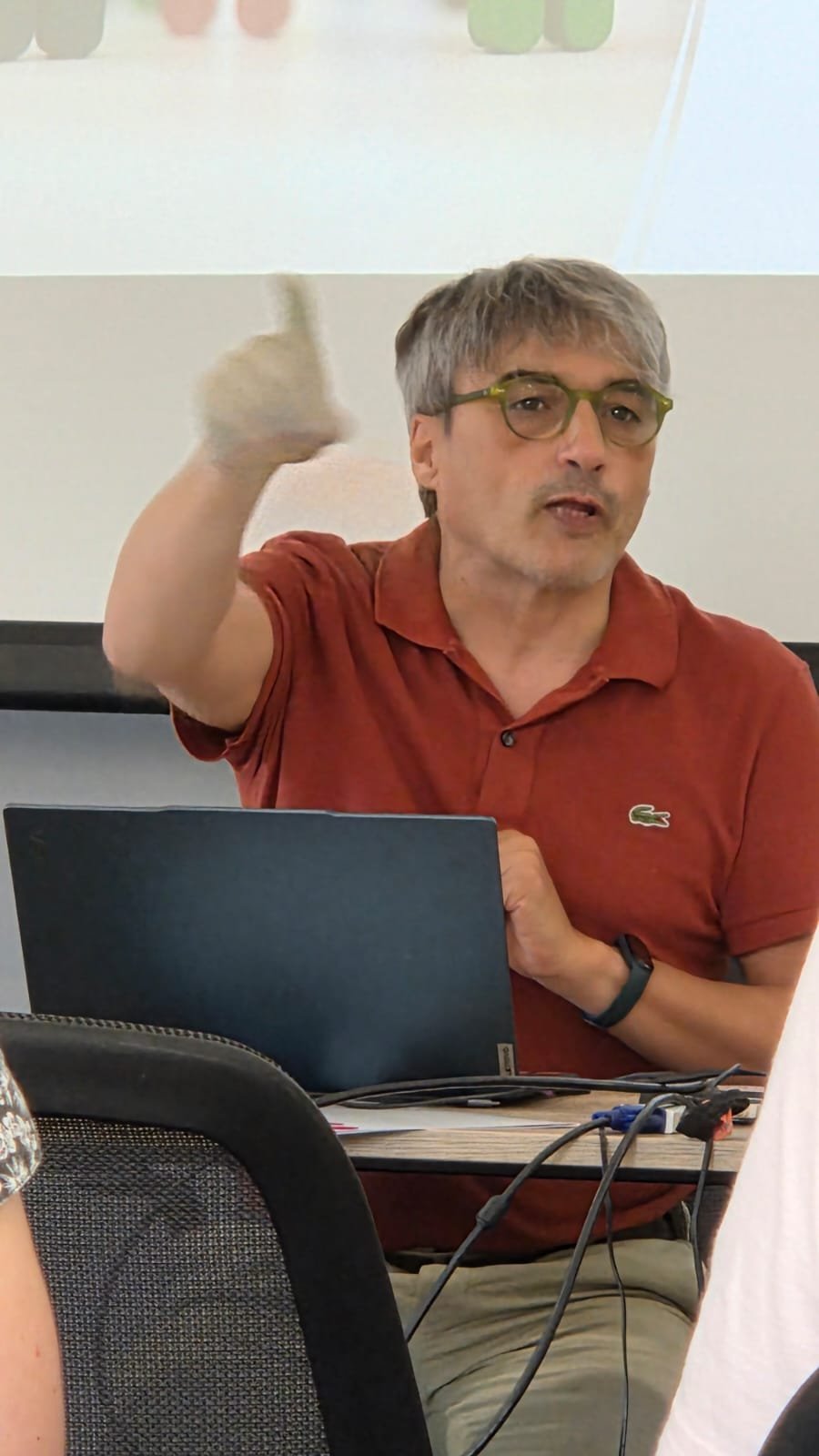
Bonsoir,
Merci pour cet article qui résume exactement, avec une justesse incroyable, ce que je constate-conscientise depuis plusieurs années, comme cadre de la fonction publique.
Un article qui confirme la necessité de remettre la qualite du travail( et pas slt la QVT!!) et les organisations au coeur des débats.